Frontin a fourni à Cologne 20 millions de litres d’eau de l’Eifel par jour
Auteur: Harry Lindelauf
Photographie: Wikimedia

Les Romains n’ont pas construit leurs célèbres aqueducs qu’à Rome. Surprise : le long de la Via Belgica entre Cologne et Tongres, on trouve de nombreux aqueducs — à Cologne, Aix-la-Chapelle, Heerlen, Voerendaal et Tongres. Voici comment tout s’articule. Aujourd’hui : Cologne.
Frontin a fourni à Cologne 20 millions de litres d’eau de l’Eifel par jour.
Un courrier venu de Rome apporte une lettre de l’empereur. Il en a assez des plaintes concernant le manque d’eau à Cologne. Pourriez-vous régler le problème — même si cela implique un aqueduc de 95 kilomètres ? Et vite, si possible : un empereur a besoin d’alliés, pas de râleurs.
Sextus Julius Frontinus est l’homme qui reçoit la lettre à Cologne : commandant de la garnison de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, au début/à la fin de la Via Belgica. Il est aussi gouverneur — et, avantage non négligeable, ingénieur.
De l’eau du Rhin ? Pas assez propre
Vers 30 apr. J.-C., Cologne possédait déjà un premier aqueduc. La ville bordait le Rhin, mais cette eau n’était pas jugée assez pure. Pour garantir une eau potable sûre, on capta cinq sources au sud-ouest de la ville. Cologne grandit toutefois si vite qu’il fallut davantage d’eau. Vers 80 apr. J.-C., Frontin se mit donc au travail.

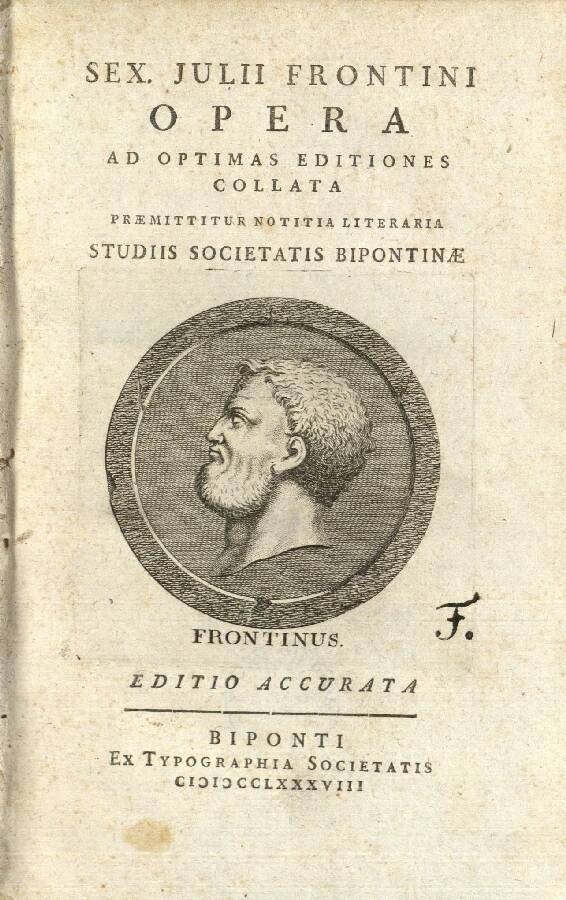
La méthode, grâce aux compétences de Frontin
1. Identifier des sources abondantes, potables et plus hautes que la ville.
2. Levé & tracé : arpenteurs et ingénieurs étudièrent finement le relief, définirent un parcours avec peu d’obstacles et un très faible pendage.
3. Construction par sections d’un peu plus de 4 km, menées en parallèle.
4. Ressources : réquisition d’arpenteurs, d’ingénieurs et de milliers de légionnaires à Cologne et Bonn, ainsi que de charrois, bœufs et matériaux (brique, pierre, ciment).
5. Route de service le long du tracé pour acheminer ouvriers et matériaux, puis pour l’entretien.
6. Travaux urbains en parallèle : pose de canaux maçonnés et de conduites en plomb dans la ville.
Maastricht–’s-Hertogenbosch
La quête des ingénieurs aboutit à 95 km de Cologne (grosso modo Maastricht–Bois-le-Duc), dans la vallée de l’Urft près de Nettersheim. On y trouva des sources d’eau d’Eifel, riches en minéraux et surtout en calcaire. L’aqueduc romain y prit naissance — 95,4 km, le plus long au nord des Alpes.
Une fois achevé, 20 millions de litres d’eau par jour affluaient vers Cologne. Un exploit étonnant avec les moyens de l’époque.

2 500 légionnaires, 16 mois
Des calculs allemands estiment qu’il fallut, par mètre linéaire, déplacer 3 à 4 m³ de terre, maçonner 1,5 m³ de mur et enduire plus de 2 m². Environ 2 500 légionnaires travaillèrent 16 mois au chantier — sans compter les levés topographiques d’une précision remarquable. La pente était d’environ 1 m pour 1 000 m (0,1 %), ce qui permit d’amener l’eau 10 m au-dessus du sol à Cologne — soit 80 m plus bas que les sources de Nettersheim.
À quoi ressemblait l’aqueduc ?
Oubliez les arches monumentales à la Pont du Gard. L’aqueduc de Cologne était un canal maçonné d’environ 70 cm de large et 1 m de haut. Il était enterré jusqu’à 1 m (hors gel). Le canal en béton étanche reposait sur une fondation de pierre et était couvert d’une voûte maçonnée pour éviter les contaminations. Des regards permettaient l’entretien et des bassins de décantation clarifiaient l’eau avant la ville.

Des matériaux au meilleur niveau
Le chantier fut rendu possible par le béton romain : chaux (éteinte ou vive) mêlée de sable, cailloux ou tuiles concassées, cendres volcaniques et eau. Le béton était coulé en coffrage — on voit encore l’empreinte des planches.
Dans l’Eifel, il fallut des ponts pour franchir les vallées. Le plus grand, au-dessus de la Swist entre Rheinbach et Lüftelberg, mesurait 1 400 m et comptait près de 300 arches. Près d’Euskirchen, un pont de 500 m complétait l’ouvrage, avec plusieurs structures plus petites.
Du béton et de la pierre… au plomb
En ville, l’aqueduc se terminait par un bassin de répartition en hauteur, afin que la gravité alimente le réseau. Les Romains utilisaient des conduites en plomb et des robinets en bronze. L’eau de l’Eifel, très calcaire, formait des dépôts protecteurs à l’intérieur des tuyaux contre la toxicité du plomb. Les concrétions calcaires de l’aqueduc furent même réemployées comme « marbre d’aqueduc » pour fabriquer, entre autres, des colonnes.

